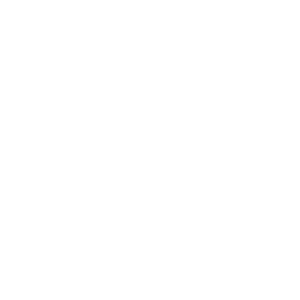par Camille Magdelaine et Yohann Derbyshire
Espagne : quand la périphérie devient le moteur de l’Europe
Il y a quelques années encore, l’Espagne était souvent décrite comme l’enfant fragile de la zone euro. Chômage endémique, dépendance au tourisme, finances publiques fragiles… À Madrid, on se contentait d’éviter la comparaison avec Berlin ou Paris. Or, voilà que le pays affiche aujourd’hui les meilleurs chiffres de croissance du continent. Pendant que l’Allemagne s’enlise dans la stagnation
industrielle et que la France s’empêtre dans ses déficits, l’Espagne surprend par sa résilience et sa vitalité. La dynamique se reflète jusque sur les marchés : quand le CAC 40 français n’a progressé que de 4,5 % en 2025 à date, l’IBEX 35 espagnol a bondi de 28,82 %, signe de la confiance retrouvée des investisseurs dans l’économie ibérique.
Le rebond d’un secteur clé
La première explication saute aux yeux : le tourisme. Après avoir été laminée par le Covid, l’Espagne profite pleinement du retour des flux internationaux. En 2024, le pays a battu son record avec 94 millions de visiteurs, soit 10 % de plus que l’année précédente. Ce secteur, qui représente 12 % du PIB, irrigue bien au-delà des hôtels et restaurants — il alimente la consommation, les services et l’investissement immobilier. Là où la France reste dépendante d’un tourisme plus saisonnier et où l’Italie souffre encore de son manque d’infrastructures modernes, l’Espagne capitalise sur un appareil touristique ultra-compétitif.
Une demande intérieure étonnamment robuste
Ce qui surprend surtout, c’est la vigueur de la demande intérieure. Les salaires réels progressent, l’emploi repart et le chômage — longtemps talon d’Achille de l’économie espagnole — reflue, même s’il reste au-dessus de 11 %, soit deux fois le niveau allemand. La politique migratoire a joué ici un rôle clé : plus de 700 000 personnes ont été régularisées depuis 2021, et près d’un million d’autres pourraient suivre. Ces nouveaux arrivants représentent à eux seuls près de la moitié des emplois créés sur les deux dernières années, offrant à la fois un relais de croissance et un appui démographique dans un pays, comme ailleurs en Europe, confronté au vieillissement de sa population (1.12 enfant par femme, l’un des taux les plus faibles de l’Union Européenne vs 1.66 en France). Environ 150 000 postes restent vacants, ce qui explique le soutien du patronat à ces régularisations. Mais la question migratoire demeure aussi une préoccupation politique majeure pour les Espagnols. Les naturalisations concernent surtout des ressortissants du Maroc, du Venezuela et de la Colombie — une géographie qui illustre le rôle de l’Espagne comme pont entre l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Amérique latine.
L’argent de Bruxelles comme catalyseur
Autre différence majeure : les fonds européens. L’Espagne est le grand gagnant du plan de relance post-Covid Next Generation EU. Les montants injectés équivalent à plus de 13 % du PIB pré-crise, de quoi financer massivement infrastructures, transition énergétique et numérisation. Là où l’Italie, pourtant bénéficiaire comparable, peine à absorber ses crédits en raison d’une bureaucratie paralysante, Madrid a réussi à déployer rapidement ces fonds. Pour les investisseurs, c’est un signal : l’État espagnol est capable de transformer une manne publique en leviers concrets de croissance. (Montant reçu : Italie 194 mds € <> 9% PIB / Espagne : 80 mds€ <> 13% PIB / France : 40 mds € <> 1.7% PIB).
Une économie qui se réinvente
Au-delà du simple rebond cyclique, l’Espagne est engagée dans une transformation structurelle. Les services à forte valeur ajoutée (finance, technologies, conseil, immobilier haut de gamme) s’imposent, tandis que l’énergie devient un véritable atout compétitif : plus de la moitié de l’électricité produite provient désormais du renouvelable, réduisant le coût de l’énergie d’environ 40 % par rapport aux pays voisins. Mais cet avantage a son revers. Le blackout massif en électricité de la péninsule ibérique d’avril 2025 a rappelé que la dépendance croissante au solaire et à l’éolien, qui représentent à eux deux près de 40 % du mix (éolien 23 %, solaire 17 %), expose le pays à des risques de stabilité du réseau. Faible inertie, stockage encore limité et interconnexions européennes insuffisantes rendent le système vulnérable aux chocs. Tant que l’équilibre avec le nucléaire (20 %), le gaz (13 %) et l’hydraulique (13 %) ne sera pas garanti, le pari espagnol des renouvelables restera aussi prometteur qu’instable.
Le revers de la médaille
Tout n’est pas idyllique. Le chômage reste élevé, les inégalités territoriales persistent et le marché immobilier est sous pression, notamment dans les grandes villes où l’afflux de touristes et de migrants alimente la flambée des loyers. Les craintes d’instabilité politique ou de tensions sociales ne sont pas éteintes non plus, dans un pays toujours travaillé par ses fractures régionales. Enfin, la dépendance structurelle au tourisme laisse planer une vulnérabilité face à tout choc exogène : crise climatique, instabilité géopolitique, ou simplement ralentissement mondial.
L’Espagne, un pari de croissance
En somme, l’Espagne incarne aujourd’hui une sorte de revanche du Sud face au Nord européen. Là où l’Allemagne peine à réinventer son modèle exportateur et où la France s’essouffle sous le poids de ses déficits, l’Espagne apparaît comme une économie jeune, réactive et dopée par des choix politiques assumés. Pour un investisseur, c’est un pari de croissance intéressant : immobilier, énergies renouvelables, consommation intérieure et services à valeur ajoutée offrent de belles perspectives. Mais c’est un pari qui reste lié à une équation délicate : maintenir l’élan actuel sans retomber dans les fragilités structurelles qui, hier encore, faisaient douter de sa capacité à durer.
L’indépendance des banques centrales : un pilier sous pression
L’indépendance des banques centrales est devenue, depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle, un principe cardinal des économies modernes. Cette autonomie vise à protéger la stabilité monétaire et, à travers elle, la santé économique de long terme. Pourtant, l’actualité récente aux États-Unis, marquée par les pressions de Donald Trump sur la Réserve fédérale (Fed), montre que ce principe reste fragile et contesté.
Un héritage historique et théorique
Historiquement, les banques centrales ont longtemps été au service des gouvernements, finançant leurs dépenses et parfois leurs guerres. Cette «monétisation» de la dette publique offrait un espace budgétaire immédiat, mais au prix d’un risque inflationniste incontrôlable. Les années 1970 en offrent une illustration : des banques centrales peu autonomes, poussées à assouplir malgré l’inflation, ont contribué à une alternance chaotique de récessions et de flambées de prix.
Depuis les années 1980, la leçon a été tirée : l’indépendance est désormais perçue comme un garde-fou indispensable. De nombreuses études empiriques (notamment du FMI) montrent qu’une banque centrale autonome réussit mieux à ancrer les anticipations d’inflation et à garantir une croissance plus stable. Loin d’être une entorse à la démocratie, cette indépendance permet d’éviter que des dirigeants, soumis à des horizons électoraux courts, manipulent les taux d’intérêt pour en tirer un bénéfice politique immédiat.
BCE et Fed : deux modèles d’indépendance
En Europe, le principe a été inscrit dans le marbre avec la création de la Banque centrale européenne (BCE) en 1998. L’article 130 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit explicitement toute influence des gouvernements ou institutions de l’UE sur ses décisions. Les statuts garantissent l’indépendance personnelle (mandats longs et non renouvelables), financière et fonctionnelle de ses dirigeants, et interdisent le financement direct des États. Son objectif est unique et clair : la stabilité des prix.
La Fed, en revanche, opère dans un cadre plus souple. Elle dispose d’un double mandat — stabilité des prix et plein emploi — et son président, nommé par le président des États-Unis avec l’accord du Sénat, reste auditionné par le Congrès. Sa gouvernance assure une responsabilité démocratique plus forte, mais l’expose davantage aux pressions politiques.
Trump contre la Fed : une menace directe
Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les attaques contre Jerome Powell, président de la Fed, allant jusqu’à menacer de le remplacer avant la fin de son mandat, pourtant juridiquement protégé jusqu’en 2026. Au-delà des pressions publiques, le président américain cherche aussi à remodeler le comité de la Fed en y plaçant des personnalités proches de sa vision économique. L’objectif est clair : forcer une baisse rapide des taux, afin d’alléger le coût de la dette publique, de stimuler la croissance et d’affaiblir le dollar pour améliorer la compétitivité américaine.
Christine Lagarde, présidente de la BCE, a récemment mis en garde : « Quand une banque centrale cesse d’être indépendante, elle devient dysfonctionnelle. L’étape suivante, c’est la confusion et l’instabilité. » Le FMI partage cette inquiétude : une vague d’élections à travers le monde accentue les risques de pressions sur les banques centrales, alors même que leur autonomie a permis de gérer la pandémie et de freiner l’inflation post-Covid.
Un principe à préserver
En pratique, un président américain ne peut pas aisément remettre en cause l’indépendance de la Fed, mais ses attaques fragilisent sa crédibilité et influencent les anticipations des marchés. En Europe, la BCE bénéficie d’une protection juridique plus robuste, ce qui rend improbable une remise en cause frontale.
L’indépendance n’est jamais définitivement garantie : elle s’appuie sur une gouvernance robuste, une transparence renforcée et une confiance constamment nourrie auprès des citoyens. Si elle peut sembler limiter la souveraineté politique, elle demeure en réalité un pilier essentiel de la stabilité monétaire et économique. La remettre en question, comme le fait Donald Trump, reviendrait à affaiblir l’ensemble du système financier international.
Retraites : quand le modèle néerlandais redessine l’équilibre social et financier en Europe
Alors que la France débat de la soutenabilité de son système de retraite par répartition, les Pays-Bas apparaissent comme un contre-modèle. Classé parmi les plus performants au monde, leur dispositif s’appuie sur trois piliers : une base publique, des régimes professionnels collectifs obligatoires et une épargne individuelle volontaire. Cet équilibre, qui associe solidarité, mutualisation et capitalisation, permet de mieux encaisser le choc démographique, dans un pays où la fécondité n’est que de 1,43 enfant par femme, bien en deçà du seuil de renouvellement des générations estimé à 2,1.
En France, les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités, sans accumulation de capital. Ce mécanisme limite les aléas de marché à court terme mais n’offre aucune performance à long terme. Les Pays-Bas ont fait un choix radicalement différent : la capitalisation collective. Chaque salarié verse environ 20 % de son salaire brut — partagé entre employeur et employé — dans un fonds de pension qui investit sur les marchés financiers. Année après année, indépendamment du rapport entre actifs et retraités, ces fonds ont constitué un patrimoine colossal de plus de 1 700 milliards d’euros, soit près du double du PIB national.
Cette réussite s’explique par un virage stratégique amorcé dans les années 1980 : diversifier massivement les placements entre obligations, actions, immobilier et private equity. Grâce à la force des rendements composés, les fonds néerlandais se sont imposés comme l’un des plus grands investisseurs institutionnels mondiaux. La comparaison avec la France est saisissante : aux Pays-Bas, l’épargne retraite représente 200 % du PIB ; dans l’Hexagone, elle plafonne à 300 milliards d’euros, soit à peine 10 % du PIB. Le système français se retrouve ainsi bien plus vulnérable au vieillissement de sa population.
Côté performance, l’avantage est tout aussi marqué. Le premier fonds néerlandais, ABP, a généré un rendement annuel moyen proche de 6 % sur vingt ans.
La réforme adoptée en 2023, la Future Pensions Act, a renforcé cette logique. Elle a mis fin au principe des pensions garanties pour instaurer des comptes individuels, adossés à des fonds collectifs. Désormais, le montant de la retraite dépend directement des cotisations versées et de la performance des placements, dans un contexte où les équilibres intergénérationnels se fragilisent. L’idée est de mieux répartir les risques entre générations, de rendre le système plus résilient aux aléas économiques et à la faiblesse des taux, et de donner aux cotisants une visibilité nouvelle grâce à des comptes personnels transparents.
Le fonctionnement s’adapte aussi à l’âge : les cotisations des plus jeunes sont orientées vers des actifs risqués — dette privée, capital-investissement, actions cotées — avant d’être progressivement réallouées, à mesure que l’échéance de la retraite approche, vers des placements sécurisés comme les obligations. Une mutualisation partielle subsiste via des fonds de solidarité, renforçant la confiance et limitant le sentiment d’injustice entre générations.
Mais cette réforme ne se limite pas à la sphère sociale. Elle transforme déjà les marchés financiers européens. Historiquement parmi les plus gros acheteurs d’obligations souveraines à longue maturité, les fonds néerlandais s’en détournent. En effet, le passage d’un système à prestations garanties vers des comptes individuels réduit fortement leur besoin de couvrir des engagements fixes à très long terme, ce qui les libère de la contrainte d’accumuler des obligations longues comme instruments de couverture. Dès lors, ils peuvent rechercher davantage de rendement pour leurs affiliés, en orientant les portefeuilles vers des actifs mieux adaptés aux horizons d’investissement : actions, private equity, dette privée ou infrastructures. Selon les estimations, ils pourraient céder ou cesser d’acheter près de 125 milliards d’euros de dette publique entre 2025 et 2028, avec un pic attendu en janvier 2026. Ce reflux bouleverse l’équilibre du marché obligataire et contribue à la hausse des taux longs, en particulier pour les dettes française et allemande.
Libérés de l’obligation de sécuriser des engagements garantis, ils redéploient leurs capitaux vers des actifs à plus haut rendement : actions, crédit, capital-investissement. Près de 100 milliards d’euros pourraient ainsi être réalloués, avec un accent croissant sur les projets européens, y compris dans des secteurs stratégiques comme la défense ou la transition énergétique.
Face à ce tableau, le contraste avec la France est brutal. L’Hexagone reste prisonnier d’un modèle par répartition, confronté aux contraintes budgétaires et démographiques. Le modèle néerlandais démontre qu’une combinaison entre capitalisation collective et gestion professionnelle peut offrir une plus grande adaptabilité. Mais cette soutenabilité accrue a un prix : une exposition directe aux aléas de marché et, potentiellement, une volatilité plus forte des pensions.
En réalité, la réforme néerlandaise agit comme un laboratoire européen. Elle illustre la capacité d’un pays à transformer son système pour le rendre viable face aux défis du XXIᵉ siècle, tout en redessinant les équilibres financiers du continent. Une question reste ouverte : si les fonds de pension se détournent massivement des obligations souveraines, qui, demain, absorbera la dette publique européenne ?